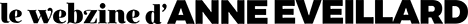Paris, ville en vie… même à l’heure du Covid-19 / chronique n°4
22 mars, 9 heures 15. « Je vous fais une copie du certificat de décès. Vous allez en avoir besoin pour la suite. Votre père est donc mort le 21 mars 2020 à 16h55… » On dirait un horaire SNCF. « Pour récupérer son alliance, c’est au premier étage. Mais le reste de ses affaires est déjà au funérarium : c’est au premier sous-sol. » Couloirs, parties communes, ascenseur, tout est vide. Aucun bénévole pour aider, accompagner, conseiller. Première escale : l’unité « Sacré Cœur » du service de soins palliatifs. « L’alliance est au coffre. Je vous la rends… Mais, désolé, vous ne pouvez pas rester ici. C’est interdit au public. » Récup’ de la bague dans une pochette plastique. Puis décollage au plus vite du 1er, pour un atterrissage forcé au « -1 ». « Le funérarium est sur votre droite. Poussez la porte Accueil des familles… » Là, tout est doux : éclairage, chaleur, couleurs. « On vous attend… » Sauf qu’il y a erreur sur la personne… « Pardon ! Je pensais que vous étiez de la famille du défunt… » Non. Ce corps toiletté, préparé, coiffé, habillé, dans le cercueil ouvert, en face d’un salon, est inconnu au bataillon. Il attend le recueillement, en solitaire, de quelqu’un d’autre. Malaise. Mal à l’aise. Pas à ma place. La mort veut jouer, brouiller les pistes, mettre à l’épreuve. Pas besoin de ça.
Deux hommes en noir, masqués de blanc
« Vous venez juste chercher les affaires de votre père ? » Affirmatif. Un type disparaît et revient avec des vêtements sales, emballés dans un sac poubelle, des propres pliés dans du papier kraft. C’est tout pour aujourd’hui. La suite : dans cinq jours, avec retour au funérarium. Cette fois, ce sera la bonne dépouille, le bon cercueil. Mais toujours pas de cérémonie. Encore moins d’aumônier. Pas d’acteurs dans le décor, à part les « chauffeurs-porteurs » des pompes funèbres : deux hommes en noir, masqués de blanc.
Pas envie de parler
Sortir. Partir. Fuir ce dimanche sans office, ni messe - sauf celle de la télé -. Plus tard, faudra penser à panser. Parce que ça fait un mal de chien, cette solitude au milieu de l’avenue Emile Zola déserte. Rentrer. A pied ? Déconseillé. Car on vit confinés. Pas envie de parler. A personne. Pas même à un chauffeur de taxi. Le taxi, on oublie. Ce sera la ligne 6. Le métro. L'aérien, comme sas de décompression. Pas trouvé mieux. Tout ça sans chialer. Car « pratique » et « pragmatique » prennent toute la place dans le wagon vidé de ses voyageurs. Pour tenir, faut écrire, décrire, raconter. Pas si facile. Pas simple non plus à « poster » sur les réseaux dits « sociaux », envahis de photos de bouffe, de chats, de fleurs, d’ateliers bricolo pour les marmots… Je débarque au milieu de tout ça avec le pire du pire, la disparition de l’un, la survie de l’autre. « L’autre », ma mère, à laquelle je viens de passer une nouvelle bague au doigt, debout dans sa cuisine, entre cellier et frigo.