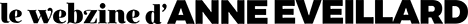Aller à sa rencontre, c’est prendre le chemin de la cinémathèque. Un bon début. Puis on pousse une porte, on passe un sas vitré, on traverse une cour qui paraît loin, très loin des bruits de la ville et de l’agitation des abords de l’AccorHotels Arena. C’est ici que Julio Villani a son atelier. Un espace tout en longueur, planqué au milieu d’immeubles en béton, qui s’ouvre sur un jardin qui, lui aussi, donne l’impression d’être parti… loin. Pas jusqu’au Brésil natal de l’artiste plasticien. Quoique… la présence d’un gris du Gabon sur un perchoir, cerné de dessins et de mobiles, apporte une touche d’exotisme à deux pas de la station de métro Bercy. « C’est mon compagnon d’atelier, confie Villani. Il a dix-huit ans, il siffle, il chante, il répète les bruits de la maison, il est feignant et pas propre, comme tous les oiseaux. » Le gosse de Marilia se souvient : « J’ai grandi entouré d’oiseaux. Gamin, j’avais toujours un perroquet sur l’épaule. »
Aller à sa rencontre, c’est prendre le chemin de la cinémathèque. Un bon début. Puis on pousse une porte, on passe un sas vitré, on traverse une cour qui paraît loin, très loin des bruits de la ville et de l’agitation des abords de l’AccorHotels Arena. C’est ici que Julio Villani a son atelier. Un espace tout en longueur, planqué au milieu d’immeubles en béton, qui s’ouvre sur un jardin qui, lui aussi, donne l’impression d’être parti… loin. Pas jusqu’au Brésil natal de l’artiste plasticien. Quoique… la présence d’un gris du Gabon sur un perchoir, cerné de dessins et de mobiles, apporte une touche d’exotisme à deux pas de la station de métro Bercy. « C’est mon compagnon d’atelier, confie Villani. Il a dix-huit ans, il siffle, il chante, il répète les bruits de la maison, il est feignant et pas propre, comme tous les oiseaux. » Le gosse de Marilia se souvient : « J’ai grandi entouré d’oiseaux. Gamin, j’avais toujours un perroquet sur l’épaule. »
Radios libres, squats d’artistes et « chien bipède »
Après des études à la fac de Sao Paulo, section arts plastiques, Villani veut voir du pays. Il part quatre ans à Londres, où il intègre la Watford school of arts. Retour au Brésil. « Mais ça n’allait pas… » Il s’envole alors pour Paris, où il termine son cursus aux Beaux-Arts. C’est l’orée des années 1980. Paris vit, vibre, entre radios libres, fêtes au Palace et squats d’artistes. Villani atterrit à l’Hôpital éphémère, rue Carpeaux. C’est là qu’il travaille et expose pour la première fois. Suivra un atelier près des puces de Montreuil. Une aubaine pour celui qui aime la récupe et l’accumulation d’objets, qu’il détourne volontiers de leur usage premier. Avec lui, des ustensiles de cuisine deviennent des volatiles, une jeannette se mue en tête de vache, un duo de manches de parapluie se fait cornes de taureau… « Je crée du rêve pour sortir de la réalité. » Tout inspire le plasticien, qui s’illustre aussi bien dans la peinture que la sculpture, les collages, la photo ou encore la vidéo. Avec pour ligne directrice, « une géométrie poétique ». Voire une poésie tout court. A l’instar de son histoire avec Magdeleine, une cane qu’il a apprivoisée lors d’une résidence d’artiste au Lycée Agricole de Périgueux, en 1999. Quand elle tenait encore dans la paume de sa main, la bête vivait dans sa poche de veste. Quand la cane a grandi, elle a trouvé sa place dans le jardin de l’artiste, qui la baladait aussi dans les rues de Paris, non pas en laisse mais dans une valise trouée pour que ce « chien bipède », comme l’appelait Villani, puisse sortir sa tête et saluer les passants.
Mobiles en forme de volatiles, bird-sitter, Calder et Picabia
 Le travail de Villani s’expose aujourd’hui dans des galeries, des musées, une vitrine de la maison Hermès, à Paris, Londres, Rio, Sao Paulo, New York, Miami… « L’avion fait partie de ma vie. » Comme ses mobiles en forme de volatiles, l’artiste prend de la hauteur. « Je ne suis pas nostalgique. Tout est en moi, tous mes souvenirs sont là, dans mon bagage… » Il conte, se raconte tout en préparant du café, accompagné de chocolats de la maison Mulot, qu’il pose sur un tabouret désormais table basse. Il s’apprête à quitter Paris pour Sao Paolo - où il a sa « deuxième maison » -, le temps de quelques vacances. Il n’emmènera pas le gris du Gabon avec lui : « J’ai trouvé une bird-sitter. » Puis Villani évoque les expos qu’il prépare à Paris et au Brésil. Un travail qu’il voit comme un jeu. « Depuis tout petit, je n’ai jamais arrêté de fabriquer mes jouets », dit encore celui qui se réfère au Dadaïsme, à Calder et Picabia dont il s’approprie cette citation : « J’ai toujours aimé m’amuser sérieusement. »
Le travail de Villani s’expose aujourd’hui dans des galeries, des musées, une vitrine de la maison Hermès, à Paris, Londres, Rio, Sao Paulo, New York, Miami… « L’avion fait partie de ma vie. » Comme ses mobiles en forme de volatiles, l’artiste prend de la hauteur. « Je ne suis pas nostalgique. Tout est en moi, tous mes souvenirs sont là, dans mon bagage… » Il conte, se raconte tout en préparant du café, accompagné de chocolats de la maison Mulot, qu’il pose sur un tabouret désormais table basse. Il s’apprête à quitter Paris pour Sao Paolo - où il a sa « deuxième maison » -, le temps de quelques vacances. Il n’emmènera pas le gris du Gabon avec lui : « J’ai trouvé une bird-sitter. » Puis Villani évoque les expos qu’il prépare à Paris et au Brésil. Un travail qu’il voit comme un jeu. « Depuis tout petit, je n’ai jamais arrêté de fabriquer mes jouets », dit encore celui qui se réfère au Dadaïsme, à Calder et Picabia dont il s’approprie cette citation : « J’ai toujours aimé m’amuser sérieusement. »