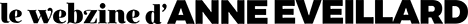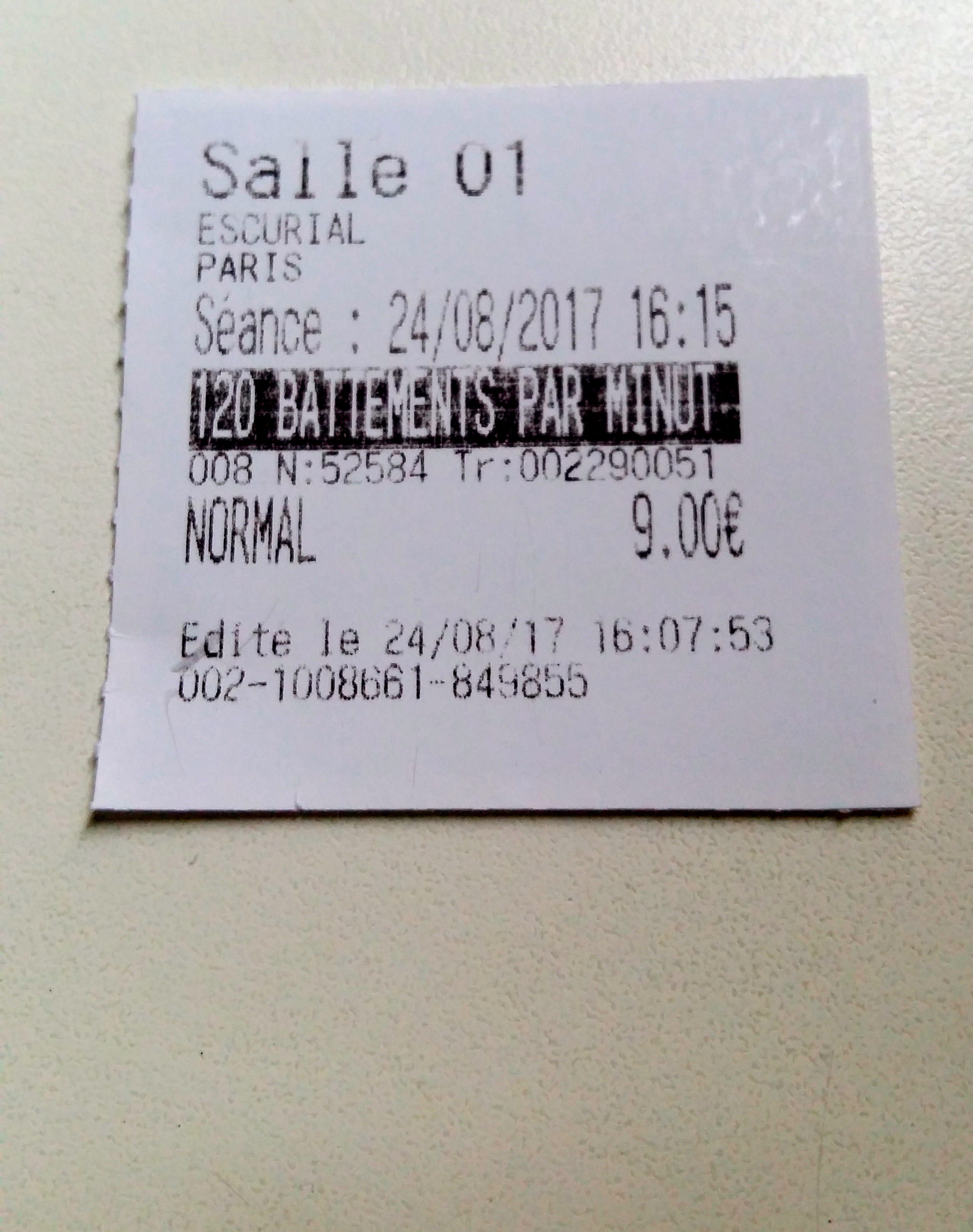Pourquoi le jury de Cannes a-t-il donné son Grand prix au film 120 battements par minute ? Parce que ce long métrage, dont le titre évoque le cœur qui s’affole, est juste. Juste sur le Sida, sur l’engagement des malades et des militants, sur les hésitations des laboratoires pharmaceutiques et du corps médical, sur l’absurdité des descentes de police… le tout à l’orée des années 1990. A l’époque, tout le monde flippe. C’est quoi ce virus ? Pourquoi le préservatif ? Comment faire face à un malade quand on n’a jamais eu un cours sur le Sida en fac de médecine ? Comment officialiser des échanges de seringues ? Et, en prison, comment faire de la prévention ?... Un quart de siècle en arrière, on ne savait pas. On ne savait rien. Tout n’était que tâtonnement, expérimentation, essai… plus ou moins tolérés par les autorités sanitaires et policières. C’est tout ça qui émane du long métrage de Robin Campillo. Un film politique, dont les héroïnes sont l’urgence, la survie et la mort.
Médecins démunis, QG de dealers, ecsta et AZT
J’ai rédigé mes premiers articles pour la presse médicale en 1991. La première enquête que l’on m’a confiée avait pour thème : « Comment prend-on en charge les malades du Sida en Ile-de-France ? » C’est à ce moment-là que j’ai compris l’utilité du RER quand on n’a pas de permis de conduire… Car il fallait que je fouine, département par département. Fouiner auprès des associations, des blouses blanches, des hôpitaux… sans téléphone portable et sans mails. C’est là que j’ai vu l’impuissance de médecins démunis face à une maladie dont ils ignoraient beaucoup, voire tout. Je me souviens de membres d’associations qui transformaient une pièce de leur appartement en chambre thérapeutique pour accueillir des malades, d’autres qui hantaient les cités HLM, lieux de prostitution, QG de dealers pour tenter de banaliser l’usage du préservatif… Je me rappelle aussi d’échanges de seringues dans un camion de Médecins du monde, stationné à la sortie du métro Château Rouge, de généralistes de quartier qui s’organisaient pour distribuer des kits de prévention aux junkies, aux ravers… parce que l’ecsta et l’AZT ne faisaient pas forcément bon ménage. Campillo le fait dire, d’ailleurs, par les militants d’Act Up-Paris dans son film. Un film parfois au bord du documentaire, avec des personnages au bord du précipice. Parce qu’en 1990, quand on avait le Sida, l’espérance de vie était courte. Très courte. Parfois quelques semaines. Les « long time survivors », comme on les appelait, se faisaient rares.
« Mon carnet d’adresses était devenu un vrai cimetière… »
120 battements par minute replonge le spectateur dans un Paris qui était alors la première ville d’Europe contaminée. J’entends encore cette directrice de boutique de vêtements, à Saint-Germain-des-Prés, qui avait fermé son rayon hommes : « Mon carnet d’adresses était devenu un vrai cimetière. Il y avait des croix partout… » A cela s’ajoutait la peur et l’ignorance. On n’embrassait pas un séropo. La police mettait des gants pour appréhender les militants d’Act Up recouverts de faux sang. Certains médecins refusaient de prendre des toxicos en consultation… quand d’autres praticiens défilaient masqués à la gay pride, pour ne pas être reconnus par leurs patients hétéros.
Techno, morphine et capote à 1 franc
J’avais déjà été impressionnée par la façon dont Campillo avait montré la gare du Nord dans son film Eastern Boys. Puis par la scène de « cambriolage » qui suivait, avec ses allures de fête à laquelle il faut participer si l’on ne veut pas y laisser sa peau… Avec 120 battements par minute, le réalisateur confirme sa quête de subtilité, esthétisme et perfection lorsqu’il s’agit de montrer la vie, la survie. Face à sa caméra, le sexe incite à la confession, la techno est à fond et on danse jusqu’à l’épuisement pour se sentir encore libre et vivant. Quant à l’excès de morphine dans les veines, il va permettre d’adoucir… un grand sommeil. Dans la salle Panorama de L’Escurial, à Paris, où j’ai vu 120 battements par minute, deux personnes sont sorties bien avant la fin du film. Sans doute dérangées ou trop bousculées. C’est vrai que les plus jeunes des spectateurs peuvent ne pas comprendre le propos. Aujourd’hui, même si Act Up milite toujours, si quelques figures du show-biz se mobilisent encore contre le Sida, la maladie s’est banalisée. Parce que l’on vit avec. Parfois très longtemps. Parce que les trithérapies sont passées par là. Il est loin, en effet, l’obélisque recouvert d’un immense préservatif fuchsia. On a oublié la capote à 1 franc. Quant à Klaus Nomi, au pire ce n’est plus qu’un visage fardé apposé sur des tee-shirts. Au mieux, la bande originale du film de Pialat, A nos amours.